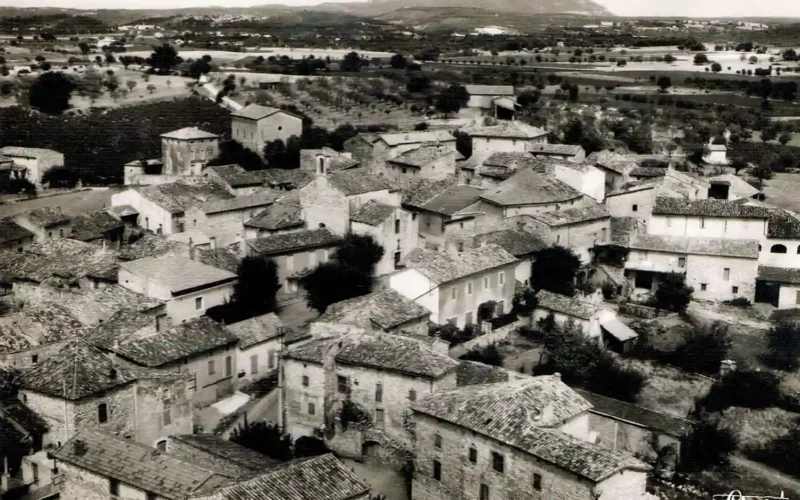Au XVIème siècle, les chrétiens se divisent et les réformes de Luther et de Calvin pénètrent dans la région. C’est à la fin 1560 que les « Réformés ou religionnaires » prennent possession des églises de la région d’Alès, dont celle de Saint-Hilaire. En 1573, une paroisse protestante est créée, la quasi-totalité de la population de Saint-Hilaire ayant alors adopté la religion réformée d’après l’abbé Goiffon[1]. Un premier temple est édifié, à quelques mètres de l’église, à une date imprécise. Si l’on en croit un plan de 1588, on constate que la nef de l’église n’existe pas et que le temple est édifié à ses côtés. La date d’édification serait donc entre 1573 et 1588 ; il est possible que la nef de l’église ait été démolie, à ce moment-là, et que les pierres aient servi à la construction du temple.
Au XVIIème siècle, la paroisse protestante compte le plus grand nombre de fidèles dans le village avec 300 religionnaires[2] contre six catholiques.
En 1652, Louis XIV veut faire appliquer le titre d’ancienneté des temples qui doivent être antérieurs à l’édit de Nantes (1598). Ce titre pour le temple de Saint-Hilaire fait, avec beaucoup d’autres, l’objet d’une enquête. Les temples devaient avoir été construits avant la proclamation de l’édit de Nantes[3] et il fallait en fournir la preuve, sinon ils étaient démolis. Les commissaires chargés de l’exécution de cette ordonnance du roi, dans la région, ont des avis discordants sur l’ancienneté d’un bon nombre de temples, dont celui de Saint-Hilaire. L’exercice du culte y reste autorisé, dans un premier temps, et la survie du temple est maintenue. Mais Louis XIV va plus loin, sous la pression de son entourage, et se met à faire appliquer l’Édit de Nantes de façon plus restrictive.
Ce premier temple sera détruit le 20 février 1685, Louis XIV ayant exigé la démolition des temples réformés, peu avant de signer à Fontainebleau, le 18 octobre de la même année, la Révocation de l’édit de Nantes. Le culte protestant, qualifié de « Religion prétendument Réformée », est alors interdit avec des conséquences terribles :
-la démolition de tous les temples encore debout.
-l’interdiction de tout exercice de la religion protestante.
-l’exil dans les 15 jours, sous peine des galères, des pasteurs qui ne voudraient pas se convertir.
-l’interdiction aux parents d’élever leurs enfants dans la religion réformée.
-l’interdiction aux protestants de passer à l’étranger, sous peine de galère pour les hommes et de prison pour les femmes.
Malgré tout, les catholiques restent minoritaires dans la commune. L’église paroissiale, dans cette période troublée, est dans un état délabré, comme le déclarent les envoyés de l’évêché de Nîmes lors de leurs visites en 1663 et 1675 : « il y pleut en plusieurs endroits et le pavé a besoin d’être refait ».
Pour les protestants, restés clandestinement fidèles à leur foi, un cycle de résistance-répression se met en place, depuis la révocation de l’édit de Nantes, aboutissant, en 1702, à la Révolte des « Camisards ». Toutes les Cévennes vont être impactées par ce conflit ; Saint-Hilaire n’y échappera pas : le 21 février 1704, le chef « Camisard » Jean Cavalier et ses hommes, brûlent l’église et le presbytère.
Il faudra attendre la Révolution Française, pour que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame la liberté religieuse. Malgré cela, au tout début du XIXème siècle, les 4/5 de la population de Saint-Hilaire sont protestants et l’église est abandonnée.
En 1838, en date du 21 juin, la municipalité adopte un projet de construction d’un nouveau temple. Mais, la municipalité précise qu’elle a des moyens limités, entre le salaire du garde champêtre, l’instruction primaire et les chemins vicinaux. En 1839, le conseil municipal précise qu’il a reçu, du ministre des cultes, une somme de 1 500 francs pour la construction du temple. Le montant total est de pratiquement 7 800F. Les propriétaires les plus aisés du village ont souscrit pour la somme de 3 960F preuve qu’il y a une réelle demande locale et attente pour la (re)construction d’un tel édifice.
Le temple sera édifié à 100m au nord de l’église actuelle. Il est mentionné en cours d’achèvement en 1842 et le 31 mars 1844, le conseil municipal peut annoncer que le temple est achevé. A ce moment-là, la commune recense 488 protestants ; de ce fait, la résidence d’un pasteur est réclamée.
Le presbytère protestant sera construit en 1853[4]. De 1874 à 1876, d’importants travaux seront entrepris, par la municipalité, dans le temple avec la consolidation des murs et surtout la création d’une charpente en bois.
Lors de la séance du conseil municipal du 25 février 1934, le maire expose que des réparations urgentes sont nécessaires au temple protestant. Le maire précise que la somme de 12 000F, prévue pour la réfection de la toiture de l’église, ne sera pas entièrement employée. Une partie de ce crédit pourrait donc être affectée aux réparations du temple pour, notamment, la révision de la toiture, des opérations de blanchissage, replâtrage et crépissage.
En 1989, des travaux de ravalement de façades ont également été opérés. Les façades ont été décroutées pour laisser apparaître les pierres qui, bien jointoyées, donnent un bel aspect à l’ensemble. Un mur d’enceinte de la petite cour a également été bâti dans le même style.
[1] Dictionnaire topographique, statistique et histoire du diocèse de Nîmes, 1881.
[2] Membres de la religion réformée.
[3] Signé en 1598.
[4] C’est le bureau de Poste actuel.