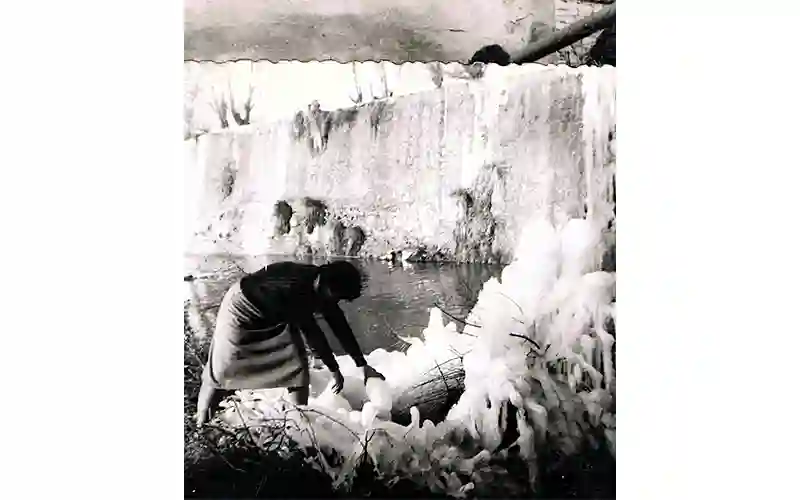Des deux anciens moulins présents sur l’Avène, le moulin du Juge est le plus en amont. Lorsque le moulin de Tribies cessa de fonctionner, les familles saint hilairoises ont continué à porter leur blé au moulin du Juge ; ce fut le cas de la famille Berrato de Tribies. Le moulin du Juge fut donc le dernier des deux à fonctionner. Il a produit de l’huile et de la farine jusqu’à sa fermeture à la fin des années 60 ; moulin en possession alors de M. Laune. On utilisait la force hydraulique pour actionner la roue du moulin, qui entraînait un axe puis faisait tourner la meule supérieure. Ce type de moulin à roues verticales, pouvaient s’installer sur tous les cours d’eau.
Autrefois, le pont actuel n’existait pas ; lorsqu’on voulait aller au village de Saint-Hilaire avec une charrette, il fallait passer par le pont de La Jasse. Toute une expédition ! En aval du moulin du Juge, se trouvait un pont de servitude qui permettait d’accéder au moulin et au mas Thérond. Cette passerelle n’existe plus aujourd’hui.
Il y avait un autre chemin très utilisé, qui longeait l’Avène, à partir de l’entreprise Capelle (de nos jours) jusqu’au moulin du Juge. Il était nommé « chemin de guerre » ; c’est aujourd’hui, pour sa partie nord, le chemin de Mardilhon qui est régulièrement impacté lors des inondations du fait de sa proximité avec l’Avène.
En direction du Mas Bruguier en partant du moulin du Juge, il faut emprunter la rue André Schenk. Directeur de la station de recherches séricicoles d’Alès, celui-ci organise le 7ème congrès international à Alès, du 7 au 13 juin 1948. Surnommé « le pape de la soie », grâce à sa stature internationale, il invite, en 1952, Josué de Castro président de la FAO[1]. Ce dernier, de nationalité brésilienne, se rend à Saint-Hilaire pour visiter le moulin du Juge, dont le mécanisme simple l’intéresse pour être transféré en Afrique, sur des projets hydrauliques.
Moulin du Juge, d’où vient ce nom ?
Nous n’avons aucune mention précisant l’origine du nom « Juge » pour ce moulin. Néanmoins, l’étude des registres paroissiaux depuis le XVIIème siècle nous donne des indications précieuses.
Tout d’abord, la première mention officielle de moulin du Juge apparaît en 1797 avec la naissance d’Étienne Veyrun le 07 décembre, fils éponyme d’Étienne Veyrun cultivateur et de Suzanne Pelet. Au cours du XIXème siècle, les actes civils se multiplient au moulin du Juge concernant essentiellement deux familles aux noms évocateurs pour les Saint-Hilairois : les Teissonnière et les Peyraube. Pour ces deux familles, les actes de naissance, de mariage et de décès évoquent le moulin du Juge. Aujourd’hui, au nord-est du moulin se trouve le chemin du mas de Peyraube et à l’est, à proximité immédiate du moulin, démarre le chemin du mas de Pérau !
Plus intéressant encore, en remontant avant 1797 plus aucune trace du moulin du Juge, mais les lieux-dits « moulin de la Bruyère » et « mas et moulin de La Bruguière[2] » apparaissent à plusieurs reprises avec notamment le décès de Jeanne Peyraube en 1778, sept jours seulement après sa naissance[3]. 10 ans auparavant un dénommé Pierre Thèbes[4] est décédé résidant au moulin de la Bruyère. Dans les registres paroissiaux, Pierre Thèbes et son épouse Suzanne Sauri ont donné naissance à Claude Thèbes en 1766[5]. Le couple réside à Larnac mais le fait intéressant est que la profession de Pierre est…meunier au moulin de la Bruyère. Quant à Suzanne, elle est de la famille de Claude Sauzet Claris…boulanger de profession.
Étant donné les noms de famille et les professions apparaissant à la période pré-révolutionnaire, il semble que ce moulin de la Bruyère, dont le nom n’apparaît plus au XIXème siècle, et le moulin du Juge soient un seul et même moulin. A partir de là, nous n’avons que des hypothèses sur les changements de noms successifs.
Plusieurs hypothèses, pour quelle vérité ?
Le toponyme « La Bruguière » ou « la Bruyère » trouve son origine dans le vocabulaire occitan et latin médiéval. Le terme vient du latin bruga (ou bruc en occitan), qui signifie bruyère. Le suffixe fait référence à un terrain couvert de bruyères. Cela désigne donc un terrain broussailleux, pauvre, souvent acide, recouvert de végétation basse, typique de certaines zones méditerranéennes. C’est un toponyme courant dans le sud de la France (notamment dans le Gard, le Tarn et l’Hérault…). On retrouve d’ailleurs la commune de La Bruguière dans le nord-est du Gard. A noter que la bruyère pouvait être utilisée en sériciculture, activité présente sur la commune notamment à la Gigalière, afin d’être utilisée par la chenille comme support pour la formation des cocons dans des élevages artisanaux de vers à soie. Concernant le terme « juge » on sait que la période post révolutionnaire a été propice aux changements de dénominations, souvent selon les propriétaires ou les fonctions exercées. Néanmoins, aucun nom ou profession d’une personne vivant à proximité du moulin nous permet de confirmer cette hypothèse. Autre possibilité, dans certaines juridictions médiévales ou d’Ancien Régime, des moulins pouvaient être associés à un droit de justice censitaire ou seigneurial. Cette hypothèse est à rapprocher de la proximité de la borne de l’octroi. Cette dernière n’est pas qu’un point fiscal, elle est aussi souvent une borne juridique, délimitant un territoire de compétence judiciaire. Le moulin pouvait alors être un point de contrôle local souvent situé près d’un pont, d’un passage à gué ou d’une route importante, lieux naturels de contrôle. Un poste d’octroi pouvait y être adossé, pour prélever une taxe sur le grain, la farine ou la mouture entrant dans une ville ou un territoire. Le terme « juge » pourrait donc faire référence à un officier royal (avant 1792) ou municipal chargé du contrôle de l’octroi, ou encore une autorité locale ayant droit de justice ou de perception sur ce territoire.
En conclusion :
A ce jour, il n’y a pas de preuve écrite formelle de la raison du changement de nom, mais l’usage local attesté du nom « moulin du Juge » et les pratiques de l’époque laissent penser à un lien avec un propriétaire ou un droit de justice associé au site, ayant remplacé l’ancien toponyme de « la Bruyère ».
[1] Food and Agriculture Organization, émanation de l’ONU qui régie toutes les questions liées à l’alimentation dans le monde et qui joue notamment un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre la faim.
[2] Qui ressemble à Mas Bruguier, hameau central de la commune, le troisième plus peuplé après le village et la Jasse.
[3] Née le 17 janvier 1778, le même jour que sa sœur jumelle Suzanne décédée aussi prématurément à l’âge de 29 ans.
[4] Contrairement aux autres avis, l’avis de décès mentionne Pierre Thèbe.
[5] Le mois n’est pas précisé, il est né le 06.