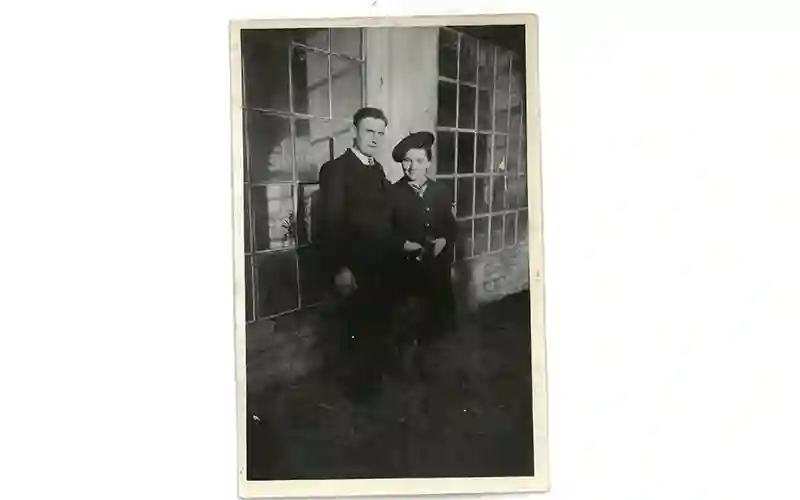- Séparé aujourd’hui du hameau de la Lègue par la voie rapide, « le Chalet », nommé ainsi en raison de son architecture d’apparence « suisse », a été le théâtre d’événements notables entre 1940 et 1944. Il a servi de refuge pour de nombreux résistants, pour des Juifs fuyant les persécutions nazies (plus d’une vingtaine, originaires de Hollande) et pour des réfractaires au STO, Service du Travail Obligatoire, institué par le gouvernement collaborationniste en 1943, pour envoyer de la main d’œuvre en Allemagne. C’était la maison d’Eugène Daufès, de sa fille Jeanne et de son gendre René Boyer.Témoignage de Jeanne Boyer (1916-2008) :Jeanne Daufès née en 1916, a épousé, en 1940, René Boyer. Dès son jeune âge, elle a évolué dans un milieu populaire et progressiste. Elle avait 24 ans au moment de la débâcle en 1940. Viscéralement républicaine et antifasciste comme l’ensemble de sa famille, elle choisit sans hésitation le camp dégarni de la résistance au régime vichyste et à l’Occupation. Son adhésion au Parti communiste (forcément clandestine) remonte à 1943. Jeanne Daufès a accepté, en 2002, de livrer son témoignage sur cette période sombre de notre histoire en s’attachant plus particulièrement au rôle des Saint-Hilairois. Après la Libération, elle poursuit son engagement dans la reconstruction et le social, notamment, au côté de Gabriel puis de Roger Roucaute. En fait, depuis 70 ans, elle est animée par la passion du bien commun. A la tête de l’Office d’HLM ou à celle de l’Entr’Aide Alésienne, qu’elle a longtemps présidée, elle a pu mesurer l’ampleur des besoins sociaux à satisfaire. C’est certainement son dévouement pour les autres qui lui permet à 86 ans[1] d’avoir cet entrain, cet optimisme à toute épreuve, cette agilité intellectuelle remarquable. Pour l’ensemble de son œuvre sociale Jeanne a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Interviewée en 2002, Jeanne Daufès témoigne ce qu’elle a vécu à cette période.
Notre commune a vécu tristement, en silence, cette période de l’Occupation. C’était le black-out. On cherchait surtout à survivre, comme dans toutes les communes de France. La déroute de mai 1940 avait été un rude choc pour les Français. L’exode de juin 40 n’a laissé personne indifférent et, à Saint-Hilaire, on a accueilli avec cœur, des réfugiés juifs venant de Hollande, plus d’une vingtaine au chalet, notre maison familiale dans le quartier de la Lègue. Quelques temps après, on a pu offrir des logements sur la région alésienne à la plupart d’entre eux. Hélas, le gouvernement de Vichy les a fait arrêter par sa police, livrer aux Allemands, ils ne sont pas revenus de l’enfer concentrationnaire : parents, enfants, tous ont péri dans les chambres à gaz. Pour sauver la famille restée au chalet, nous avons recherché le moyen de confectionner des papiers d’identité. Grâce à quelques fonctionnaires courageux, on a réussi, et à partir de ce moment-là, nous avons pu apporter des solutions à bien des personnes en danger de mort. Il fallait agir prudemment, les dénonciateurs anonymes et la milice de Vichy étaient là, à l’affût de la moindre indiscrétion. Les hommes au béret et au costume sombre étaient prompts à arrêter, torturer et exécuter ou à livrer aux occupants. Les charniers de Saint-Hilaire et du puits de Célas[2] témoignent de leur cruauté. Ces Français inspiraient un profond dégoût aux hommes épris de liberté. Ils étaient l’incarnation même du fascisme, ceux qui avaient dit « plutôt Hitler que le front populaire ». Ils ont massacré les Juifs, les communistes, ils ont torturé, tué tous les républicains qui refusaient de rester passifs devant l’Occupation et ses alliés français. Bien sûr, la peur était là, mais, il y avait des sentiments plus puissants qui poussaient à l’action pour combattre le fascisme, l’oppression, l’injustice ; faire des papiers d’identité, cacher des personnes recherchées, des jeunes qui refusaient de partir travailler en Allemagne, être une sorte de plaque tournante pour les hommes qui désiraient rejoindre tel ou tel maquis, les y accompagner, les ravitailler afin d’aider ses admirables Cévenols qui, au prix de leur vie, les accueillirent à Saint Frézal de Ventalon, Saint Martin de Boubaux, Saint Jean de Valériscle, Lasalle, Coutach, etc. On doit retenir ce courage tranquille des habitants de notre commune qui acceptaient de cacher quelqu’un chez eux, le faisant passer pour un ouvrier agricole, de ceux qui hébergeaient une nuit, ou quelques jours, un réfugié en transit. Je pense notamment aux familles Bancilhon, Sayn, Théron, Roche, Royer, Laurent, Mme Rioult, Germain Salah, etc. Aujourd’hui, la plupart de ces gens simples qui, localement, ont risqué leur vie pour que vive une France libre, nous ont quittés. Quant aux quelques activistes pétainistes saint-hilairois, par respect pour leur descendant, j’ai choisi d’enfouir leur nom au tréfonds de ma mémoire.
Notre maison a été, au printemps 1944, envahie par un groupe de SS[3] sous les ordres d’un français. Nous avions chez nous huit personnes qui se cachaient. Avertis par son épouse de l’arrestation d’un camarade[4], nous étions préparés à une descente de l’ennemi et nous avons eu juste le temps de nous échapper avec les réfugiés. Seules, les personnes âgées restées sur place ont été inquiétées, la maison a été mise à sac, mais le tunnel salvateur, qui reliait la cave à une forêt de bambous, située non loin de là, n’a pas été découvert. Mon père Eugène Daufès, malgré son âge (72 ans), a été malmené et incarcéré à la sinistre prison du fort Vauban. Comme la fouille du chalet s’avéra infructueuse, pour les SS, et qu’au fort Vauban, Eugène Daufès ne reconnut aucun des suspects présentés, qui eux-mêmes eurent le courage de ne point le dénoncer, il finit par être relâché après un interrogatoire « musclé ». Il dut probablement son salut à son apparente innocence de grand-père mais aussi au cynisme des geôliers SS, qui jouaient la vie de certains prisonniers à pile ou face[5].
René, mon mari, est parti au maquis de Coutach près de Quissac ; moi-même, je suis restée cachée chez des amis avec lesquels je travaillais dans la Résistance, assurant, en particulier, l’acheminement des informations et le courrier pour un réseau. En juin 44, Michel Bruguier (alias commandant Audibert) responsable départemental des FFI, tout juste âgé de 23 ans, réussira à fédérer plusieurs réseaux de résistants. Toutes nos actions, petites ou grandes, ont contribué à doper la Résistance en France : celle-ci à harcelé les occupants, les a rendus inquiets, plus vulnérables ; elle a combattu le nazisme, bien avant le débarquement de nos alliés et ainsi préparer la Libération. Aucun livre ne sera suffisamment exhaustif pour raconter, dans le détail, le rôle joué par les uns et par les autres dans les combats libérateurs et pour évoquer toutes les anecdotes émouvantes, parfois pittoresques, souvent tragiques. Aujourd’hui, j’ai le cœur serré en songeant à mes camarades, ces « humbles et discrets héros » qui ont donné leur vie pour la liberté, à ceux qui sont morts des suites d’incarcération, à ceux qui ont survécu avec de terribles séquelles physiques et morales à leur retour des camps de prisonniers ou pire de concentration, à ceux qui ont perdu des êtres chers. Je suis malheureusement consternée à la pensée que tant de Français ne puissent reconnaître l’ombre du fascisme ou voir le danger qu’encourt notre liberté. Faire barrage à la violence, la haine et l’injustice sociale en pensant aux sacrifices consentis par mes amis ; demeurer vigilante pour combattre les instincts politiques dangereux, la démagogie et le racisme de l’extrême droite. Malgré mon âge avancé, ces engagements restent pour moi une exigence républicaine, une éthique vitale, un devoir civique.
[1] Son âge en 2002.
[2] Voir le panneau sur les maquisards.
[3] Schutzstaffel, créée en 1925 comme escadron de protection d’Hitler.
[4] Dénoncé, Georges Sujol fut arrêté par la Milice en possession de plusieurs vraies-fausses cartes d’identité destinées aux réfugiés du chalet. Effroyablement torturé au fort Vauban d’Alès, il sera martyrisé au puits de Célas avec d’autres résistants en juin ou juillet 1944.
[5] Le 24 août 1944, jour de la libération de Saint-Hilaire, c’est Eugène Daufès qui prononcera le discours sur la place de la mairie. A la demande du comité de Libération et du Préfet, il présidera la délégation spéciale qui administrera la commune jusqu’aux élections de 1945. Son gendre, René Boyer, sera l’un des vice-présidents. Ils céderont leurs fonctions en mai 1945 à Paul Sol (maire) et Maurice Saussine (adjoint) nouvellement élus.